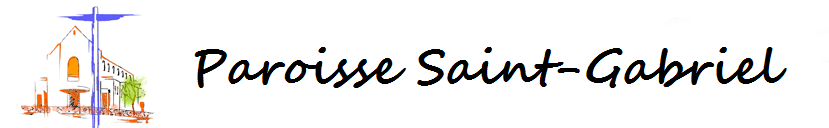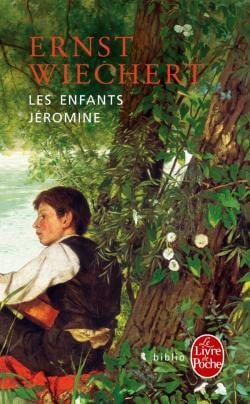
un roman de Ernst Wiechert.
Il y a à peu près 45 ans, au temps joli (?) où j’étais collégien, mon professeur d’allemand avait fait traduire aux élèves de ma classe un extrait des “Enfants Jéromine” de Ernst Wiechert tout en ne tarissant pas d’éloges sur les très grandes qualités de ce roman. Il faut croire que ces propos s’étaient logés dans un coin quelconque de mon cerveau puisque, il y a quelques semaines, en voyant ce livre sur l’étal d’une librairie, je m’en suis souvenu. Et je me suis dit qu’il était grand temps, après toutes ces années, de le lire enfin, ce roman, et de vérifier par moi-même si le dithyrambe de mon ex-professeur était justifié.
Aujourd’hui, l’ayant lu (et c’est un roman de plus de 1000 pages), je peux dire que oui, en effet, il s’agit bel et bien d’un chef d’oeuvre de la littérature. Et j’ajoute qu’il faudrait redonner toute sa place au très grand écrivain que fut Ernst Wiechert.
“Les Enfants Jéromine”, achevé d’écrire en 1946, se divise en deux parties, la première très dramatique et très sombre, la deuxième beaucoup plus lumineuse bien qu’il y soit question de la montée du nazisme et de l’instauration de son effroyable régime.
L’ensemble du roman se déroule durant la première moitié du XXe siècle, essentiellement à Sowirog, un petit village allemand sis au coeur d’une forêt proche de la Pologne. C’est là que vit (ou que survit) la famille Jéromine. Le père, charbonnier de son métier, gagne juste de quoi nourrir ses sept enfants. La pauvreté, voire la misère, sont le lot commun de la quasi totalité des habitants du village. Dans la première partie du roman, Wiechert relate essentiellement cela, les dures conditions de vie de la famille Jéromine et des autres familles du bourg, les famines, les maladies, la mort. Cette dernière est omniprésente, et bien davantage encore lorsque survient la grande guerre. Le ton du livre confine au désespoir. Le pasteur du village est si ébranlé par les tragédies qui frappent ses ouailles qu’il en perd la foi.
Mais au cœur de cette désespérance commence à poindre une lumière, ce que développe la deuxième partie du roman. On y suit la destinée et les choix de vie de Jons, le benjamin des enfants Jéromine. L’instituteur du village s’étant pris d’affection pour lui et croyant en ses dons, il réussit à l’envoyer à la ville pour y faire des études. Jons a la chance de rencontrer des guides, parmi lesquels, tout particulièrement, un juif du nom de Lawrenz. Car le garçon réussit si bien dans ses études qu’il entreprend de devenir médecin. Ayant passé brillamment ses examens, se pose pour lui la question de son orientation. Tout le monde le voit déjà chirurgien de renom, mais Jons, guidé par son mentor et gardant le souvenir de son enfance, de son père qui lui lisait la Bible, de la misère sévissant à Sowirog, fait le choix du retour à son village. Plutôt que d’être un grand médecin gagnant somptueusement sa vie, il préfère être le médecin des pauvres, de ceux qui n’ont jamais eu qui que ce soit pour les secourir quand ils étaient malades. C’est ce que raconte la fin du roman, tout éclairée par de belles figures (celles de Jons, de Lawrenz et de plusieurs autres habitants du village). Paradoxalement, par contraste, survient au même moment la montée inexorable du nazisme. La menace est là, grondante, de plus en plus présente, elle tue, mais la plupart des habitants de Sowirog ne pactise pas avec elle.
Ce grand roman est aussi, il faut le préciser pour finir, tout imprégné de Bible, de foi chrétienne, de recherche de Dieu. On peut dire, me semble-t-il, que la première partie du roman, sombre et désespérée, est celle de l’absence ou du silence de Dieu (le pasteur de Sowirog perd la foi, je l’ai dit), tandis que la deuxième partie est celle de la foi retrouvée, ou en tout cas d’un chemin de foi à nouveau possible.
Même lorsqu’on le lit dans une traduction française, on perçoit que le roman est doté d’un style et d’un ton qui lui sont propres et qu’on a affaire à un grand écrivain. Ce n’est pas un roman facile à lire, il faut faire un effort de lecture pour en venir à bout, rien à voir avec les guimauves indigestes d’un Paulo Coelho par exemple, mais cet effort est largement récompensé. Mon seul regret, c’est d’avoir attendu si longtemps (45 ans!) pour le découvrir !
NOTE: 9,5/10
Luc Schweitzer, sscc.