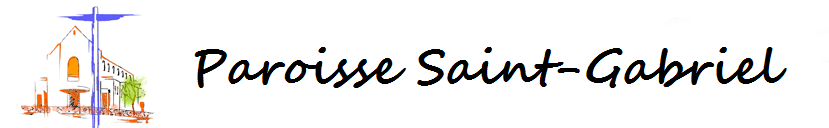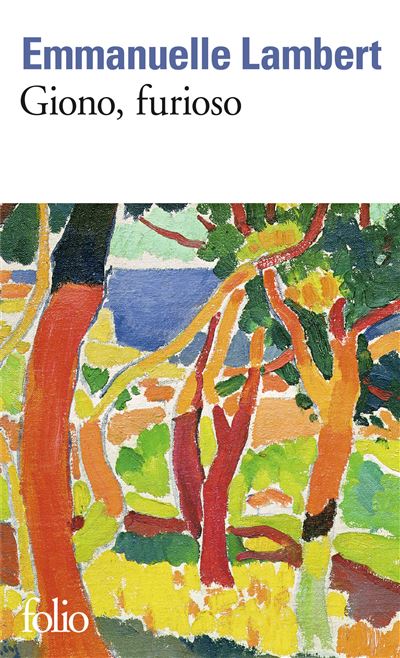
Un livre de Emmanuelle Lambert.
Observons quelques-uns des portraits photographiques de Jean Giono (on peut en trouver facilement sur le net). Presque toujours, l’homme semble nous fixer avec un sourire au coin des lèvres. « …il nous regarde comme s’il se payait notre tête, écrit Emmanuelle Lambert. Si on l’observe attentivement, on lui trouvera un air à la fois bonhomme et détaché, un air narquois. » « On ne le dit pas, ajoute l’écrivaine, mais on dirait bien qu’il se fout de nous. » Pas question pour Emmanuelle Lambert, on le comprend dès les premières pages de son livre, de se contenter de quelque cliché que ce soit sur le romancier de Manosque. Réduire Giono à quelques idées toutes faites (l’écrivain « solaire », l’amoureux de la nature, le « sorcier de la langue »), c’est peut-être passer à côté de l’essentiel. On ne cerne pas Giono facilement et, si l’on a la prétention de le faire, on est sûr de se fourvoyer, tant reste impénétrable tout un pan de mystère chez cet homme.
Le mieux, quand on veut écrire sur Giono, c’est de ne pas viser une impossible objectivité (il devrait d’ailleurs en être de même pour tout essai biographique ou analytique sur qui que ce soit). Beaucoup de celles et ceux qui se prêtent à cet exercice l’ont compris, de nos jours. Emmanuelle Lambert (à l’exemple de ce que fait un Emmanuel Carrère) n’hésite donc pas à passer de la troisième à la première personne, du « il » au « je », dans son évocation de Giono. Ce que l’écrivaine propose, c’est son regard sur cet écrivain qu’elle fréquente et qu’elle aime, que, manifestement, elle a lu et relu, dont elle sait remarquablement analyser l’œuvre et dont elle parvient tout aussi admirablement à préserver l’énigme.
Il ne s’agit pas de raconter Giono en long et en large, encore moins en prétendant à une illusoire exhaustivité, il s’agit de cheminer avec lui, d’en faire une sorte de compagnon de route, même si ce n’est que par le truchement des livres. Emmanuelle Lambert l’a compris, il y a, comme chez tous les écrivains de cette génération, une rupture brutale, traumatique et fondatrice à la fois, pour qui est revenu de l’enfer. Jean Giono, né en 1895 (et mort en 1970), part à la guerre alors qu’il n’a que dix-neuf ans. Il y perd son ami le plus proche et en revient marqué à jamais. «… petit soldat anonyme, écrit Emmanuelle Lambert, on l’a expulsé de sa vie, pétri avec les autres et roulé dans la chair à canon. On l’a pris, on l’a jeté à terre, on l’a précipité dans la confusion, les piétinements, la folie, la boue, les hurlements, le métal. Et, pour finir, on a tué son meilleur ami. »
Contrairement à d’autres écrivains, revenus vivants de la grande boucherie de 14-18 et qui en relatèrent leur expérience sans tarder, il faut beaucoup de temps à Giono pour écrire quoi que ce soit sur cette guerre. Rares sont les textes qu’il y consacre : une nouvelle (Ivan Ivanovitch Kossiakoff) en 1925 et, surtout, Le Grand Troupeau en 1929. Néanmoins, on peut dire, sans risque de faire erreur, qu’implicitement, la guerre est présente partout chez Giono, dans son œuvre, dans ses prises de position, dans ses comportements, dans le regard qu’il porte sur les humains.
Quand, précisément, Giono commence à pressentir le spectre d’une nouvelle guerre, quand, déjà, dès 1929, il en voit poindre la menace, c’est alors qu’il se met à rédiger des professions de foi pacifistes. Non pas qu’il veuille se placer « au-dessus de la mêlée », au contraire, mais parce qu’il veut s’impliquer pour tenter de l’arrêter : « partout, il hurle l’horreur absurde de la tranchée, son dégoût du patriotisme. Il dit une chose simple : il a peur. »
Et, quand la guerre est là, tout au long de la deuxième guerre mondiale et, singulièrement, pendant l’Occupation, Giono, semblable à beaucoup d’autres Français, reste dans le flou. Nous qui aimons tant mettre des étiquettes aux autres, nous voilà embarrassés, car Giono, comme tant d’autres, n’a pas sa place dans une catégorie : il n’est ni résistant ni collabo. Excepté dans son Journal où il semble se soucier fort peu de leur sort, il ne tient aucun propos malveillant sur les Juifs. Cela étant, si, d’un côté, il participe à un journal collaborationniste, de l’autre il cache des Juifs et a quelques amis dans le maquis.
Giono n’a rien d’un homme exemplaire. Mais est-ce ce qu’on demande aux écrivains ? Emmanuelle Lambert n’écrit pas sur l’auteur du Hussard sur le Toit comme le ferait une admiratrice énamourée, même si elle est, c’est le moins, enthousiaste dès qu’il s’agit d’en commenter les œuvres. Et puis, elle met en évidence des thèmes, un regard, un pessimisme foncier dont on peut supposer que l’origine remonte à l’expérience traumatique de la Grande Guerre. Ainsi en est-il lorsque Giono raconte le rapport de l’homme à la nature, lorsqu’il entrevoit les catastrophes à venir et le devenir de l’humanité. On a voulu faire de lui un « professeur d’espérance (…) prônant un modèle rural et autosuffisant économiquement ». Certes ce n’est pas entièrement faux mais, au fond, comme le perçoit Emmanuelle Lambert, « son imaginaire et son flair sont catastrophistes ». Bien avant le pape François et son encyclique Laudato Si, Giono, dès les années 1930, perçoit que « tout est lié ». Dans des contes écrits à cette époque-là, « les êtres humains (…) sont présentés comme la plus grande menace jamais portée par la terre pour les autres êtres vivants. » Mais, pour Giono, il n’y a pas d’échappatoire : « ses visions de fin du monde (…) valent encore aujourd’hui, où nous regardons disparaître insectes, lombrics, oiseaux sans réagir, comme anesthésiés, ou trop gorgés de profit pour prendre la mesure de ce que nous faisons. Sans accepter humblement que, par avidité, nous tuons des choses plus grandes que nous. L’Apocalypse de Giono l’avait prédit : nous serons engloutis parce que nous refusons de comprendre une chose pourtant simple : (…) nous n’avons pas plus de droit que la bête. » 8/10
Luc Schweitzer, ss.cc.