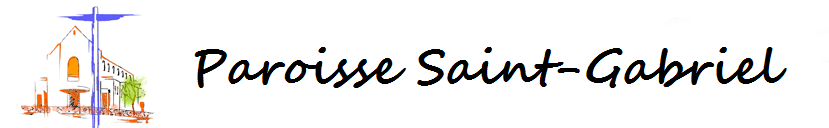Un film de Steven Spielberg.
C’est à croire qu’ils se sont passés l’un à l’autre le témoin ! Après Alfonso Cuarón dans Roma (2018), Kenneth Branagh dans Belfast (2021) et James Gray dans Armageddon Time (2022), c’est au tour de Steven Spielberg de faire de ses propres souvenirs d’enfance et d’adolescence un film. Certes, le réalisateur de E.T. ou de La liste de Schindler l’assure, il y a quelque chose de lui dans un chacun de ses films. Mais réaliser un film entièrement autobiographique, c’est un autre défi et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat laisse pantois d’admiration. En puisant dans son histoire, en allant à la source de sa vocation, Spielberg se livre à une analyse formidablement aboutie de son art et c’est, évidemment, passionnant.
Au départ de toutes les grandes vocations, n’y a-t-il pas une révélation, un éblouissement, un choc, un événement dont on reste marqué à jamais ? Pour Spielberg, ce fut un soir où, alors qu’il était enfant, ses parents l’emmenèrent pour la première fois au cinéma. C’est ainsi que le petit Sam (c’est le prénom de l’alter ego de Spielberg, le nom de famille étant changé en Fabelman) découvrit un film qui venait d’être programmé sur les écrans (nous sommes en 1952), Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille. Une scène le fascina et le terrorisa à la fois, tout en lui révélant l’incroyable pouvoir du cinéma, celle où l’on voit un train se fracassant contre une voiture puis contre un autre train. Rentré à la maison, le garçon resta hanté par ces images et, bientôt, pour Hanouka, reçut en cadeau un train électrique, puis une modeste caméra. Et c’est ainsi que l’enfant commença à tourner ses premiers films, en essayant de reconstituer, avec ses moyens, la scène choc du film de DeMille.
Une vocation était née, qui ne demandait qu’à s’affermir en allant de découverte en découverte. À l’âge de 16 ans, Sam (désormais brillamment joué par Gabriel LaBelle) s’avise d’un autre pouvoir des images, celui de mettre en évidence ce qui était caché. Avec son père Burt (Paul Dano), un scientifique de renom, et sa mère Mitzi (Michelle Williams), une pianiste de talent, avec ses trois sœurs, il a vécu des années heureuses. Mais un film qu’il a tourné à l’occasion d’un pique-nique en pleine nature, pique-nique auquel était convié également Bennie (Seth Rogen), un collègue de son père et ami de la famille, lui ouvre les yeux. En le visionnant dans le but de réaliser un montage de diverses séquences, Sam découvre un secret que sa mère avait maladroitement tenté de sauvegarder, un secret qui est là, clairement inscrit sur la pellicule, un secret qui déchire le cœur du garçon et lui fait entrevoir ce qui va fatalement advenir : l’effondrement de sa famille. Se pose alors pour le cinéaste en herbe une question morale : que faire des séquences filmées qui mettent en cause sa mère ? Les projeter ? Les garder pour soi ? Quel pouvoir redoutable peut donc avoir un cinéaste, même quand il n’est encore qu’un adolescent qui se contente de chroniquer en images des événements familiaux ?
Burt et Mitzi, les parents, Spielberg prend un soin extrême à ne pas les schématiser. Le père, le scientifique, l’homme pragmatique, s’il manifeste, à certaines occasions, des réticences en voyant son fils de plus en plus accaparé par sa passion pour le cinéma, n’en demeure pas moins à son écoute, un père attentif et aimant. La mère, l’artiste contrariée, la femme fantasque dont il faut préserver les mains (c’est pourquoi, pour éviter de devoir faire la vaisselle, on ne mange qu’avec des objets jetables chez les Fabelman), si elle approuve la vocation de son fils, si elle est une mère aimante, n’en est pas moins celle qui cause la plus grande douleur à Sam, cette mère qui s’était mise à danser de manière fort impudique, un soir d’été, éclairée par les phares d’une voiture. En les mettant en scène avec précision et délicatesse, en se mettant en scène lui-même sous les traits du jeune Sam, d’une certaine façon, Spielberg fait sur écran une sorte d’auto-psychanalyse mais, évidemment, bien plus captivante que tout ce qui pourrait être dit sur un divan.
À cause du travail du père, les Fabelman sont contraints de déménager à plusieurs reprises, d’est en ouest, jusqu’à s’établir en Californie, là où vivent les « hommes-séquoias-géants », des garçons qui en imposent par leur taille et leur sportivité. S’il ne s’agissait que de cela, que de se sentir petit et chétif à côté de tels condisciples, ce ne serait pas bien grave. Mais le pire ne tarde pas à advenir lorsque Sam se trouve en butte, pour la première fois de sa vie, à des propos et des brimades antisémites. Cela ne l’empêche d’ailleurs pas d’expérimenter un premier flirt avec une jeune chrétienne dont on se demande si elle est sincère quand elle prétend vouloir le convertir. Mais surtout, à nouveau, dans un contexte de brutalité raciste, le fait de filmer, s’il s’apparente à une sorte de protection contre la haine et la bêtise, donne à son auteur un réel pouvoir sur autrui. Nous le savons bien aujourd’hui, avec nos téléphones portables qui peuvent avoir une fonction de mini caméra, que détenir des images et, éventuellement, avoir la possibilité de les manipuler nous dote d’un pouvoir très grand.
Je n’ai nul besoin d’en dire davantage pour faire saisir combien ce film de Spielberg est intéressant à bien des égards. Qu’un cinéaste aussi doué ait l’ambition de puiser à la source de sa vocation tout en proposant à la fois une bouleversante représentation des membres de sa famille et une réflexion des plus pertinentes sur la grandeur de son art, cela ne peut être banal. Pas plus que ne le fut, comme le montre la dernière scène du film, la rencontre-éclair entre le tout jeune apprenti cinéaste et l’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma, le mythique John Ford. Juste le temps d’une leçon de mise en scène des plus judicieuses et Sam est déjà congédié, mais avec, dans le regard, une étoile qui brille et brillera jusqu’à son dernier jour.
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.