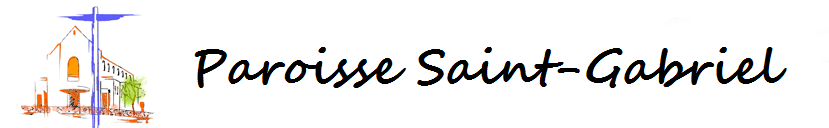Un film de Pawel Pawlikowski.
« Ida », son succès ô combien mérité de 2014, a probablement incité le polonais Pawel Pawlikowski à adopter, pour ce nouveau film, les mêmes choix stylistiques : photographie en noir et blanc et format carré de l’image. Des choix qui, cependant, ne donnent pas le sentiment d’une simple redite, loin s’en faut. On comprend, dès les premières scènes, qu’ils sont totalement judicieux, qu’ils conviennent parfaitement à ce film, si parfaitement qu’on a le sentiment, de voir une œuvre qui compte déjà parmi les grands classiques incontournables du cinéma. Formellement, tout, dans « Cold War », est quasi parfait. Les cadres et les mouvements de caméra (quand il y en a) semblent toujours extraordinairement justes. Pas un plan, pas une scène, de ce film ne donnent une impression de banalité. Techniquement, voilà un exemple idéal de ce qui est approprié à l’art cinématographique.
Évidemment, pour qu’un film soit proche de la perfection, il lui faut aussi être séduisant du point de vue du contenu et pas seulement de celui de la technicité. Or, ici, tout est incroyablement fascinant à la fois pour les yeux, pour l’esprit et pour l’intelligence. Le film comble sur tous les plans. Et, bien sûr, comme dans les films les meilleurs, il laisse un grand espace de participation au spectateur, Pawel Pawlikowski misant sur son intelligence et sa puissance d’imagination et ne se croyant pas tenu de tout raconter dans les détails.
Au risque de « spoiler » un petit peu, je me dois de mentionner, pour commencer, la superbe épanadiplose que propose le film, l’une des belles qu’on ait vues au cinéma. De quoi s’agit-il ? Eh bien, tout simplement, de la reprise d’une même scène ou d’une scène semblable se déroulant dans un même lieu, au début et à la fin de l’œuvre. Or, dans « Cold War », les deux scènes trouvent leur juste place dans une église à moitié en ruine. Au début du film, le spectateur découvre cette église en se demandant pourquoi le cinéaste a cru bon de la montrer. On y aperçoit la fresque d’un visage (probablement celui du Christ) dont il ne reste que les deux yeux, des yeux qui semblent nous regarder comme ils regardent l’homme qui s’est introduit dans le lieu. On y voit aussi le dôme qui s’est écroulé, laissant au sommet de l’église une grande trouée vers le ciel. À la fin du film, le cinéaste filme à nouveau la même église et tout s’éclaire de façon sublime. Car, cette fois-ci, le bâtiment sert de cadre à un mariage, le plus simple et le plus dépouillé qui soit : rien qu’une bougie sur un autel et les deux amoureux qui échangent leurs consentements, sans ministre du culte, sans autre témoin que les yeux de la fresque murale fixés sur eux et l’infini du ciel au-dessus de leurs têtes. On se croirait dans l’un ou l’autre des films les plus personnels de Frank Borzage (1894-1962), cinéaste génial chez qui les scènes de mariage du même style (sans autre témoin que Dieu) sont récurrentes. C’est d’une beauté à couper le souffle, même si, en l’occurrence, chez Pawlikowski, la scène de mariage n’est pas dénuée d’une dimension tragique.
Le reste est à l’avenant. Entre ces deux scènes d’église, bien des années se sont écoulées. Le film commence en 1949 et se termine en 1964. Autrement dit, en pleine période de guerre froide. Pawel Pawlikowski s’est inspiré de l’histoire de ses propres parents pour nous raconter celle de ses héros de cinéma, Wiktor (Tomasz Kot) et Zula (Joanna Kulig). Leur rencontre a lieu parce que le premier, musicien et même compositeur, fait partie d’une équipe chargée de collecter et d’enregistrer des chants traditionnels et populaires au fin fond des campagnes polonaises, un peu à la manière de ce que firent, quelques années auparavant, les compositeurs Bela Bartok et Zoltan Kodaly en Hongrie. Cependant, dans la Pologne de ces années-là, le but n’est pas seulement de préserver un patrimoine, mais de le vivifier en sélectionnant une équipe de chanteurs et de danseurs qui se produiront sur scène. C’est à cette occasion que Wiktor fait la connaissance de Zula et que la séduction opère. On a beau prévenir le premier que cette jeune fille n’est guère fréquentable (elle a subi une condamnation pour avoir blessé son père d’un coup de couteau – un père qui, explique-t-elle, a eu la fâcheuse idée « de la confondre avec sa mère), il n’en a cure. Zula non seulement est admise comme membre de la troupe folklorique mais elle en devient rapidement l’une des vedettes.
Du fait du contexte historique de guerre froide, l’histoire d’amour de Wiktor et Zula se complique rapidement. Arrive bientôt, pour la troupe folklorique, l’obligation d’intégrer dans leurs prestations des œuvres vantant la gloire du communisme triomphant et de Staline en personne. Pour Wiktor, le risque de la liberté s’impose. Profitant d’une tournée à Berlin, il parvient à passer de l’autre côté et à rejoindre Paris. Mais, pour Zula, ce n’est pas si simple. Elle a beau aimer Wiktor, elle ne se résout pas à le suivre. Tout n’est pas fini cependant entre les deux amoureux, loin de là. Sans ménager les ellipses, les sauts de plusieurs années (Pawel Pawlikowski n’éprouve pas la nécessité de tout expliquer, fort heureusement), le cinéaste montre, tout particulièrement, les périodes de retrouvailles des deux amants. Pendant un temps, même, Zula parvient non seulement à retrouver Wiktor à Paris mais à demeurer avec lui, sans cependant trouver l’équilibre qu’elle cherchait. Elle est déçue, elle est fantasque, elle se moque d’une poétesse dont s’est entiché Wiktor, elle ne supporte pas de rester à Paris. Mais ni les désillusions ni les emportements ne peuvent rien contre les cœurs et c’est, en fin de compte, Wiktor qui, profitant d’un voyage dans la Yougoslavie de l’époque pour revoir Zula qui s’y produit, revient à son point de départ.
Je ne peux terminer mon éloge de ce film sans en souligner les mérites du point de vue musical. Les musiques et les danses y sont omniprésentes. Bien sûr, de nombreuses scènes font écho au talent de la troupe folklorique polonaise dont fait partie Zula. Mais, Wiktor étant lui-même compositeur et musicien, la musique est présente partout. À Paris, dans les cabarets qui lui sont dédiés, explosent les rythmes du jazz. Une autre scène nous montre Wiktor travaillant à la musique d’un film. Et, surtout, le scénario fait de la place aux séquences les plus sensibles du film, lorsque Zula et Wiktor, s’étant retrouvés pour un temps, la première chante au micro tandis que le second l’accompagne au piano : instant de beauté inoubliable durant lequel on a le sentiment que les deux amants font l’amour par chanson interposée.
Ce film, qui a reçu un Prix de la mise en scène à Cannes, mérite, en vérité, d’être complimenté sur tous les plans. C’est lui, sans nul doute, qui aurait dû être couronné de la Palme d’Or.
NOTE: 10/10
P.S.: J’ai vu le film en avant-première. Il sortira sur les écrans le 24 octobre.
Luc Schweitzer, ss.cc.