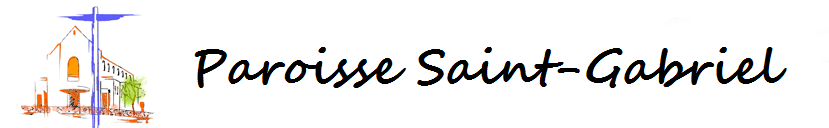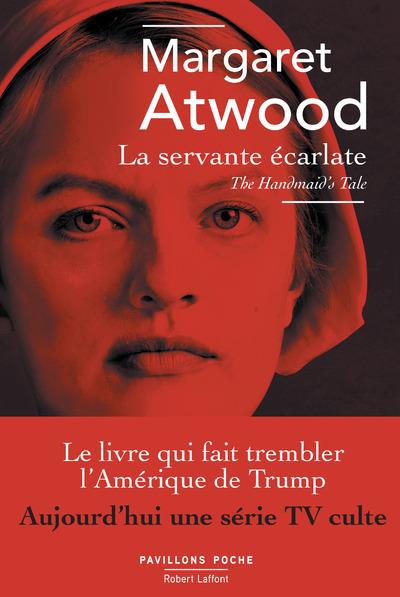
un roman de Maragaret Atwood.
Paru pour la première fois en 1985, ce roman a aussitôt été couronné de succès au point qu’il a été traduit dans de multiples langues, n’a cessé d’être réédité et a été vendu, de par le monde, à des millions d’exemplaires. Déjà adapté au cinéma par Volker Schlöndorff en 1990, le voici aujourd’hui arrangé sous forme de série télévisée (que je n’ai pas encore pu voir, mais qui a droit à beaucoup de critiques très élogieuses). Du coup, le récit de Margaret Atwood, qui, paraît-il, est parfois brandi aux États-Unis par les féministes comme un manifeste anti-Trump, connaît un succès encore plus grand qu’avant et ses éditions se vendent comme des petits pains !
Essayons de le lire sans à priori, sans tenir compte de l’engouement dont il fait l’objet, et d’en mesurer la valeur avec un regard neuf autant qu’il est possible. Je m’y suis efforcé et, comme de nombreux autres lecteurs, j’ai été conquis. L’auteure s’est clairement inspirée des grands romans dystopiques (c’est-à-dire décrivant une société imaginaire à tendance cauchemardesque) déjà écrits (et, eux aussi, très justement célèbres) comme « Le Meilleur des Mondes » de Aldous Huxley et « 1984 » de George Orwell. Mais elle a su créer son monde à elle, si l’on peut dire, y insérant des menaces et des peurs spécifiques et ancrées dans les réalités contemporaines. De ce point de vue, même si le livre a été rédigé au milieu des années 80, il est clair que l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en réactive considérablement la pertinence.
Le roman étant écrit à la première personne du singulier, il faut accepter, en tant que lecteur, de ne percevoir le monde auquel il nous confronte que de manière partielle, par le truchement du regard de sa narratrice. De plus, comme cette dernière fait partie des classes les plus réprimées et les plus soumises de sa société, sa perception en est forcément affectée. Ce n’est donc que par bribes, et quasiment jamais de manière globale, que l’on découvre l’environnement glaçant dans lequel elle évolue. Seules des « notes historiques », insérées à la fin de l’ouvrage, nous en donnent une vision plus complète en nous faisant appréhender quelque peu les événements qui ont conduit à l’instauration d’un état dictatorial appelé Gilead.
Auparavant, le lecteur doit se contenter de découvrir cet univers terrifiant, dont les frontières semblent se confondre avec celles des États-Unis d’aujourd’hui, en compagnie de Defred, puisque tel est le nom qui a été imposé à la narratrice par ses oppresseurs. Si ce pays semble menacé par des guerres du côté précisément de ses confins, il n’en est pas moins entièrement bâti sur le modèle le plus despotique qui soit : tout y est strictement hiérarchisé et chacun de ses membres doit se conformer au rôle qui lui est attribué, sous peine, s’il s’en écarte, d’être envoyé dans un bagne appelé « les Colonies » ou même puni de mort lors d’une cérémonie macabre, les corps des suppliciés étant ensuite exposés sur un Mur. Il va sans dire que la surveillance est totale, si totale et si répressive que ceux qui en sont chargés sont appelés les « Yeux ».
Au fil du récit sont nommés les différentes catégories de personnes qui composent la société hiérarchique et rigide de Gilead : entre autres, du côté des hommes, en plus des Yeux, les Anges (qui semblent être des combattants) et les Commandants ; du côté des Femmes, les Épouses, les Tantes, les Marthas (qui semblent être des surveillantes) et les Servantes. Ces dernières, dont fait partie Defred, ont pour seule fonction d’être des reproductrices. La baisse de fécondité ayant atteint un seuil critique, les femmes capables de procréer en sont réduites à n’être rien de plus que des réceptacles devant mettre au monde des bébés. Elles doivent être fécondées par les Commandants au cours de Cérémonies au rituel implacable et machinal se déroulant en présence des Épouses, tout cela étant justifié par la lecture de passages bibliques !
Car, il faut le préciser, l’État totalitaire de Gilead a été fondé par des fanatiques religieux : la Bible leur sert de référence ou plutôt des extraits bien choisis de la Bible, car la lecture intégrale en est interdite. Seuls les Commandants sont habilités à lire les passages censés justifier leur conduite. Quant à la religion, au sens le plus rétrograde du terme, elle imprègne tous les comportements et tous les protocoles auxquels sont soumis les habitants de Gilead.
Mais, bien sûr, et c’est ce qui en fait l’intérêt, ce roman ne se contente pas de décrire cette société, il en montre aussi les failles et les hypocrisies. Toute collectivité, aussi assujettie soit-elle, comporte ses fragilités. Derrière les apparences, se dissimulent des réalités cachées, des sentiments interdits, des lieux inattendus, et aussi un réseau secret de rébellion. Et donc, peut-être, un espoir de libération pour Defred et ses semblables…
Étant donné les thèmes qu’il aborde, ce roman à la fois terrifiant et passionnant garde toute sa pertinence. Comme tous les grands récits dystopiques, il prend en compte des réalités de notre temps en les exacerbant afin de nous mettre en garde et de nous rendre vigilants. Que deviendraient nos pays aux mains de fanatiques rétrogrades qui, s’appuyant sur une religion, quelle qu’elle soit, en la dévoyant, asserviraient la population et feraient des femmes des esclaves ? Ces périls, nous rappelle Margaret Atwood dans une brève mais fort intéressante postface, ne sont pas des chimères : c’est « la brutale théocratie de la Nouvelle-Angleterre puritaine du XVIIe siècle, avec ses préjugés contre les femmes » qui est le fondement profond des États-Unis, écrit-elle. En lisant « La Servante écarlate », c’est ce qui vient à l’esprit : soyons sur nos gardes et battons-nous pour que les errements et les terreurs du passé ne se réactivent pas dans le futur !
NOTE: 9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.