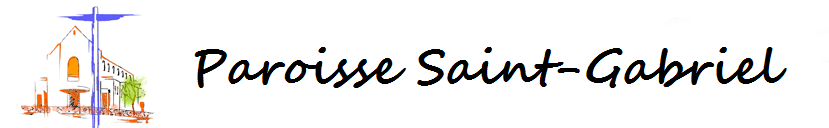Un roman de Aharon Appelfeld.
Grâce à Valérie Zenatti, qui en est la fidèle traductrice, l’œuvre de Aharon Appelfeld, mort en janvier 2018 en Israël, continue de nous parvenir. Chaque livre, chaque roman se présente comme une pièce de plus dont l’ensemble constitue une œuvre d’une qualité littéraire et, tout bonnement, humaine remarquable. La Stupeur, qui vient de paraître aux éditions de l’Olivier, se détache néanmoins du tout. Dernier roman écrit par Appelfeld, juste avant son décès à l’âge de 85 ans, il se présente comme une variation de plus sur le traumatisme de la Deuxième Guerre Mondiale et le massacre des Juifs, mais au moyen d’un parti-pris singulier, inédit dans l’œuvre du grand écrivain.
Né en 1932 près de Czenowitz (ville qui était alors roumaine et est maintenant ukrainienne), le petit Aharon fut privé de sa mère, assassinée en 1940, puis, alors qu’il était dans un ghetto, séparé à jamais de son père. Aharon, lui, parvint à survivre, d’abord en s’échappant d’un camp, puis en se cachant dans la forêt avec des marginaux, enfin, après avoir été recueilli quelque temps par des paysans, puis dans l’Armée Rouge, en traversant l’Europe pour gagner l’Italie et s’embarquer clandestinement pour la Palestine. Ces incroyables aventures ont nourri l’œuvre romanesque d’Appelfeld. Souvent, d’une manière ou d’une autre, on y retrouve le petit garçon qu’il fut, se cachant pour échapper à la furie destructrice des nazis et de ceux qui collaboraient avec eux.
Cependant, dans La Stupeur, c’est à une autre approche que s’est essayé le grand écrivain. Cette fois, c’est une femme, qui plus est une Ukrainienne, qu’il a imaginé comme porte-parole. C’est elle qui est au cœur de ce roman, c’est sa destinée que raconte le romancier, une destinée qui, j’en fais le pari, marquera durablement chacun des lecteurs du roman. Cette femme se prénomme Iréna, elle est mal mariée, depuis huit ans, à Anton, un homme fruste dont elle doit supporter, malgré elle, les assauts inlassables (ce qu’on appelle aujourd’hui le viol conjugal). Surtout, elle découvre, un matin, que ses voisins, les Katz, une famille de petits commerçants juifs, le père, la mère, leurs deux filles, Blanka (qui souffre de légère déficience mentale) et Adéla (qui rêvait de terminer ses études d’infirmière) sont contraints de rester alignés dans la rue sous la surveillance d’Ilitch, un gendarme ukrainien qui ne cesse de justifier chacun de ses actes en répétant qu’il ne fait qu’obéir aux ordres des Allemands (« Ce sont des gens cultivés, qui ne font pas n’importe quoi », répète-t-il).
La voilà, la stupeur, qui ne cesse de grandir au fil des pages. Ces Juifs, que connaissait si bien Iréna (particulièrement Adéla, dont elle était proche, tout en la jalousant un peu), les voilà désignés à la vindicte populaire, comme s’ils étaient responsables de tous les maux. Dans un pays déjà miné par l’antisémitisme, ils sont les victimes toutes trouvées. Iréna ne le supporte pas, quant à elle, elle fait ce qu’elle peut pour soulager leurs souffrances, leur donne un peu de soupe, leur suggère même de s’évader. Mais rien n’y fait. Ilitch les oblige à creuser une fosse et, le lendemain, au petit matin, ils ont été exécutés.
Pour Iréna, c’est un choc dont elle ne se remettra pas. Commence alors, pour elle, un long périple, une longue et incessante recherche d’un éventuel pardon. Elle quitte, sans regret, son sinistre mari, et marche, découvrant l’horreur, car, dans tous les villages, tout comme dans le sien, les Juifs ont été exterminés. La quête d’Iréna la conduit d’abord vers deux personnages : d’une part, sa tante Yanka, une femme qui vit dans un isolement presque total, gardant précieusement le souvenir d’Hugo, un étudiant juif qu’elle aima jadis (malgré les injonctions du curé qui affirmait que « la nature juive est traîtresse ») et qui sait trouver les mots qu’il faut pour aider Iréna à sortir de sa culpabilité (« Nous ne nous préoccupons que de nous-mêmes et de nos maux. Nous ne savons pas aimer. Dieu ne nous le pardonnera pas », dit Iréna. « Dieu pardonne toujours », répond la tante.) ; d’autre part, un homme solitaire, qu’on appelle le Vieux (détesté par les curés, qui le traitent de sorcier) qui confie ces paroles à Iréna : « Le sentiment de l’amour a été dévasté en toi, tu dois entreprendre de le restaurer. »
Or, tandis qu’elle demeurait chez la tante Yanka, Iréna, un jour où elle contemplait une icône, a eu une révélation. Tout à coup, elle a compris clairement que Jésus, ce Jésus qu’on lui avait appris à prier, lui aussi, était juif, et toute sa famille était juive. C’est aussi une stupeur pour Iréna, tant on lui avait appris (y compris dans la bouche des curés) qu’il fallait détester les Juifs. Dès lors, forte de cette révélation, quitte à être prise pour folle, Iréna se met à sillonner le pays en répétant partout que Jésus et toute sa famille étaient juifs. On se moque d’elle, on lui jette des pierres, mais elle reste fidèle à sa mission. « Jésus était juif, explique-t-elle. Il faut être clément envers ses descendants qui sont morts, et ne pas se comporter avec eux en usant de la force ». C’est sa manière, autant que faire se peut, de réparer un peu du mal qui a été commis, tout en se guérissant de sa propre culpabilité (tant elle estime qu’elle n’a pas assez fait pour les Katz, dont les visages lui apparaissent toujours).
On remarquera que c’est auprès des femmes qu’Iréna trouve, en règle générale, les oreilles les plus attentives et les cœurs les plus ouverts à son message. Tandis que les hommes lui jettent des pierres, les femmes se montrent, souvent, accueillantes et attentives, capables de changer de regard. C’est le cas, entre autres, de celles qui se retrouvent dans une auberge qui ne reçoit que des femmes, c’est le cas, aussi, des quelques prostituées qu’a l’occasion de rencontrer Iréna. Alors que le pays est en proie non seulement aux exactions des Allemands mais aussi à une épidémie de typhus, Iréna ne déroge pas à ce qui est devenu sa vocation : « Il n’y a plus de magasins juifs, dit-elle, plus de dépôts de marchandises, de moulins. Levez-vous et demandez pardon aux assassinés. »
Composé de 65 chapitres courts, cet ultime roman d’Appelfeld, avec son personnage si original et si touchant et sa thématique si prenante, doit être considéré, sans nul doute, comme une œuvre majeure, disons le mot, comme un des chefs d’œuvre du grand romancier.
10/10
Luc Schweitzer, ss.cc.