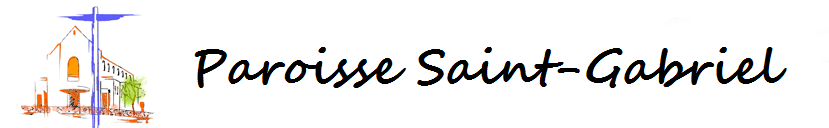Un roman de Walter Tevis.
Publié initialement en 1980, ce roman de science-fiction à caractère dystopique a été réédité en janvier dernier par les éditions Gallmeister. Un de ses thèmes principaux n’est pas sans rappeler celui que traita Ray Bradbury (1920-2012) dans son fameux Fahrenheit 451 (1953) qui fut adapté au cinéma par François Truffaut en 1966. Walter Tevis (1928-1984), en effet, tout comme son aîné, imagine une société futuriste qui interdit les livres. Cela étant, L’Oiseau moqueur ne peut être considéré comme un sous-produit du premier, la question de la lecture et des livres y occupant certes une place importante, mais dans un cadre et une logique propres auxquels l’auteur a conféré une indéniable originalité ainsi qu’une parfaite cohérence.
L’une des grandes singularités du roman, c’est le rôle accordé aux robots et, en particulier, à l’un d’eux nommé Robert Spofforth. Oui, un nom d’humain pour un robot, d’autant plus qu’on a affaire à un spécimen de classe 9, autrement dit l’élite de ces créatures. L’action du roman se situe aux États-Unis, à New-York et autres lieux, en l’année 2467. Or les robots, nous fait comprendre le récit, ont été construits bien longtemps auparavant et leurs concepteurs les ont perfectionnés de plus en plus, jusqu’à ce niveau de classe 9, un niveau où les robots ont été conçus, voulus, à l’image de l’homme. En somme, l’homme s’est mis à la place de Dieu, créant des créatures à son image à lui.
Or, à partir de ce moment-là, tout s’est déréglé, le monde s’est engouffré dans une logique folle et suicidaire. On a certes cessé de construire des robots, mais le mal était fait. Et, dans le monde tel que l’a imaginé Walter Tevis, les robots ont pris toute la place. Ils gouvernent tout, font tout, contrôlent tout. Mais ils sont à la fois forts et faibles. Ils peuvent s’en prendre à un humain insubordonné, voire l’arrêter, mais sont limités par leur propre programmation. Il leur arrive aussi de tomber en panne, tout en étant capable de s’autoréparer. Pour un robot de classe 9 comme Spofforth, la crème des robots, les concepteurs sont allés aussi loin qu’ils le pouvaient en intégrant dans son système le schéma de connaissances d’un cerveau humain. Spofforth semble même avoir des sentiments, mais il peut aussi ressentir une fatigue telle qu’il voudrait en finir et se suicider. Comment faire cependant quand on a été programmé pour vivre sa vie de robot sans jamais en finir ?
C’est en lien avec Spofforth que se situent les deux autres personnages principaux du roman : Paul Bentley et Mary Lou. Tous deux, précisément, empruntent des chemins qui les marginalisent par rapport aux normes que les robots sont chargés de faire appliquer. D’une part, parce que, dans un monde où les livres sont interdits et où, de ce fait, on n’apprend même plus à lire, Paul et, à sa suite, Mary Lou découvrent, par leurs propres moyens, en autodidactes pourrait-on dire, le bonheur d’apprendre à lire afin d’être lecteur et lectrice. Des livres, en effet, ils réussissent à en trouver dans des lieux où ils sont cachés. Non seulement des livres d’ailleurs, mais aussi des films muets des débuts du cinéma, films qui, pour être compris, obligent à savoir lire les intertitres. C’est un monde disparu, c’est une somme immense de connaissances, qui datent d’avant ce que, dans le monde géré par les robots, l’on appelle « la mort de la curiosité intellectuelle », que, médusés, découvrent les deux humains. Ils le font à leurs risques et périls car les robots veillent et, bientôt, les font arrêter, juger (ce qui donne lieu à des pages à la fois effrayantes et cocasses, effrayantes du fait des moyens dont on se sert, cocasses parce qu’il faut, au préalable, par exemple, nettoyer un juge plein de poussière) et condamner. C’est surtout Paul qui paye les pots cassés, au point qu’il écope de six ans de prison, dont deux de travaux forcés. Mais, bien décidé à ne pas demeurer prisonnier sur une aussi longue durée, Paul réussit à s’évader, ce qui donne lieu à des pages parmi les plus captivantes du roman. Il s’agit, en effet, pour le fugitif, de survivre dans un environnement hostile quasiment vide d’humains, si ce n’est une étrange communauté d’hommes et de femmes qui se déclarent « chrétiens », ce qui donne l’occasion à Paul de faire valoir, à la surprise générale, ses capacités de lecteur. Il faut noter, à ce propos, que, parmi les livres trouvés par ce dernier, figure une Bible, qu’il essaie de décrypter et de comprendre, lui à qui l’on n’avait jamais enseigné qu’il pouvait y avoir un Dieu.
Quant à Mary Lou, restée seule avec Spofforth, qu’elle appelle volontiers Bob, il se passe en elle, dans ses entrailles, quelque chose de totalement inattendu : elle est enceinte ! Pour en mesurer la surprise, il faut savoir que, dans le monde tel que l’a imaginé le romancier, non seulement la population terrestre a considérablement chuté, mais, de plus, il n’y a plus de naissance depuis une trentaine d’années. Les humains sont désormais stériles, pour une raison qui trouve son explication au cours du récit. Tous, sauf Mary Lou ! Mais que peut devenir l’enfant à naître, dans un monde où le genre humain tout entier est en péril (plus d’un, d’ailleurs, préférant se suicider plutôt que d’attendre la mort inéluctable).
Je n’en dis pas davantage afin de ne pas trop dévoiler les nombreuses, passionnantes, trépidantes aventures contées dans ce roman. Un roman qui parvient admirablement à concilier les péripéties et les questionnements de fond. Un roman qui, sous couvert d’anticipation, nous interroge, nous, les humains du XXIème siècle, sur ce que nous construisons et programmons, en particulier quant aux multiples avancées scientifiques et à leur potentiel vertigineux. Walter Tevis l’écrit : des sociaux-ingénieurs ont « tout programmé dans le passé, inventant un monde censé être sans pauvreté, sans maladie, sans dissension, sans douleur (…), un monde rendu possible par les pouvoirs de la technologie et de la compassion. » Or, dans ce monde aseptisé, il manque l’essentiel, ce que Paul Bentley résume ainsi : « Ce que je voulais, ce que je désirais, ce que j’avais toujours désiré, c’était être aimé. Et aimer. Et ce mot, on ne m’avait même pas appris qu’il existait ». 8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.