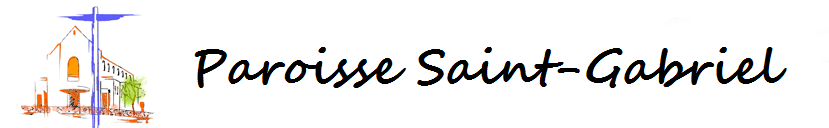un film de Ken Loach.
Je l’avoue, lorsque j’ai eu connaissance de l’attribution de la Palme d’Or du dernier festival de Cannes à ce film, ma première réaction fut celle d’un cinéphile dépité. Je me suis dit : « Pourquoi une deuxième Palme d’Or à Ken Loach (après celle reçue pour « Le vent se lève » en 2006) ? N’aurait-il pas été plus judicieux de récompenser un cinéaste plus jeune et n’ayant pas encore été gratifié d’un prix ? » Cela étant dit, aujourd’hui, maintenant que j’ai vu le film du réalisateur anglais, je comprends combien et pourquoi il a séduit le jury du festival et je me dis que c’est loin d’être un mauvais choix. Car « Moi, Daniel Blake » peut sans nul doute être classé parmi les meilleures réalisations de Ken Loach (avec « Raining Stones » – 1993 – par exemple, ou encore « Ladybird » – 1994 – et d’autres films de cet acabit) et l’attribution de la Palme d’Or peut lui donner, je l’espère, le rayonnement qu’il mérite.
Une fois encore, aidé de son fidèle scénariste Paul Laverty, Ken Loach réussit à la perfection un grand film politique, un film d’indignation et de combat, mais sans jamais l’alourdir d’un poids ouvertement idéologique. Plusieurs commentateurs ou critiques ont cru bon de dénoncer le caractère prétendument manichéen de « Moi, Daniel Blake » mais, à mon avis, tous se sont fourvoyés. Le terme de « manichéen » ne peut nullement s’appliquer à ce film. Si l’on tient absolument à lui accoler un qualificatif, seul celui de kafkaïen peut convenir. Le film montre que ce qu’on appelle l’Etat-providence s’est tellement dégradé qu’il a engendré un système d’inhumanité, un système qui ne tient plus compte des personnes, mais dont le but est de s’auto-réguler en appliquant indifféremment les mêmes directives à tous ceux qui font appel à lui. Ce système n’engendre pas des bons et des méchants, mais il met face à face des employés d’administration chargés d’exécuter des ordres et des demandeurs qui risquent de n’être pas mieux considérés que s’ils étaient des pions. Ken Loach est si peu manichéen qu’il a pris soin de mettre en scène l’un ou l’autre employé d’administration ayant encore conservé son souci d’aider sincèrement les demandeurs, tandis que d’autres, il est vrai, n’ont plus d’autre objectif que d’appliquer les règles imposées. Il ne cherche pas à séparer les bons des méchants, il a l’ambition de dénoncer un système qui humilie les plus faibles au point d’en faire des laissés-pour-compte en même temps que des assistés.
Certains n’ont pas ou n’ont plus leur place dans la société d’aujourd’hui, tel le personnage éponyme du film, Daniel Blake, un charpentier de 59 ans qui, après avoir subi une attaque cardiaque, perd son travail. Le voilà pris entre deux feux, dans une situation kafkaïenne : d’un côté, son médecin lui interdit de reprendre un travail, de l’autre l’administration veut le contraindre à chercher un travail, sous peine, s’il s’y refuse, à le laisser sans ressources. Forcé de respecter d’obscures procédures, obligé de remplir des questionnaires sur internet (lui qui ignore tout du fonctionnement d’un ordinateur), contraint d’assister à l’application de règlements administratifs humiliants, il comprend que tout est conçu, d’une certaine manière, pour le pousser à l’exclusion, lui et tous ceux qui lui ressemblent. Que peut-il surgir, dès lors, des entrailles de Daniel Blake, sinon un désir de révolte ? De la révolte, oui, il y en a dans le film de Ken Loach, mais il y a aussi autre chose : il y a la solidarité des humbles, des petits, des laissés-pour-compte. C’est ce qui donne au film un ton extrêmement touchant, poignant, qui va droit au cœur. Le système administratif a beau faire de Daniel Blake un révolté, il lui reste son cœur qui bat (même si c’est un cœur affecté par la maladie). C’est un homme au cœur sur la main, comme on dit, et qui n’hésite pas une seconde à se mettre au service de Katie, une femme rejetée par le système comme lui mais ayant à charge deux enfants. Daniel Blake fait tout ce qui est en son pouvoir pour les aider, leur donner du baume au cœur, etc. Il ne mesure pas sa générosité. Si les rejetés de la société ont tout perdu, il leur reste néanmoins cela : l’entraide, la solidarité, l’amitié. L’inhumanité du système administratif n’a, fort heureusement, pas détruit l’humanité de ceux qui en sont les victimes. Quelques scènes bouleversantes du film (en particulier celle qui se déroule dans une banque alimentaire) nous montrent l’humain dans ce qu’il a de plus fragile et de plus noble.
Ken Loach, âgé de 80 ans aujourd’hui, avait décidé, je crois, de ne plus réaliser de film après « Jimmy’s Hall » en 2014. Fort heureusement, il n’a pas pu se retenir de se mettre à nouveau derrière la caméra et de nous offrir ce grand film, ce film de révolté, ce film exaltant la générosité des plus petits. Qu’il en soit remercié !
NOTE: 9/10
Luc Schweitzer, sscc.